MAISONS D'ARTISTES Anne-Laure Sol, ancienne conservatrice du patrimoine à la Région Île-de-France, retrace l'histoire et présente les caractéristiques des musées et ateliers d'artistes franciliens dans l'ouvrage "L'Île-de-France, un autre patrimoine".
L’ouvrage "L'Île-de-France, un autre patrimoine" s'appuie sur 40 années de recherche à l'inventaire général, et invite à découvrir ou redécouvrir les mille et une facettes du patrimoine francilien : ses églises gothiques et ses châteaux Grand Siècle, mais aussi ses aérogares, ses stades, ses cités-jardins et ses villes nouvelles, en passant par ses paysages de bord de Seine ou ses villages de caractère, qui ont inspiré les grands peintres du XIXe siècle. Découvrez tous les mois un extrait de chaque thématique abordée dans l’ouvrage.
Terre d'inspiration : musées et ateliers d'artistes en Île-de-France
Initiée à partir du XVIe siècle, la distinction progressive entre l’atelier de l’artisan et celui de l’artiste révèle la mutation qui touche la conception du « métier » d’artiste, qui, affranchi du statut d’artisan, conquiert celui de créateur. Toutefois, la forme concrète de l’atelier, conditionnée par les besoins de la création, connaît peu de variantes depuis les débuts de l’époque moderne : un espace à la grande hauteur, au rez-de-chaussée pour les sculpteurs, en étage pour les peintres, parfois traversé d’une mezzanine et dont les verrières sont idéalement exposées à la lumière du nord.
Sous le règne d’Henri IV, artistes et artisans d’art sont établis dans le palais du Louvre, un privilège confirmé par Louis XIV. Peu nombreux, les ateliers situés hors de la résidence royale sont aménagés dans des maisons ou des immeubles, et les hôtels construits pour des artistes n’abritent pas d’espace de travail. C’est en 1787, lorsque Jean Baptiste Pierre Lebrun, marchand de tableaux, fait aménager dans l’hôtel Lubert, par l’architecte Raymond, un atelier de peintre pour son épouse Élisabeth Vigée-Lebrun et une galerie d’exposition dotée d’un éclairage zénithal, que la forme architecturale de l’atelier s’impose pour connaître rapidement une fortune importante.
Pour permettre le transfert au Louvre des oeuvres saisies en Italie, le Consulat, avec l’arrêté du 20 août 1801, procède à l’expulsion des artistes. Certains d’entre eux sont relogés au collège des Quatre-Nations et à la Sorbonne, mais la majorité des artistes reçoit une allocation pour prendre un atelier dans Paris, notamment sur la rive gauche, provoquant l’émergence de quartiers artistiques, dont l’expansion et la multiplication s’accentuent tout au long du XIXe siècle, en écho à la démocratisation de la condition d’artiste et à la réforme de l’École des beaux-arts de 1863.
Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, la typologie des ateliers s’étend du « coin de misère mal tenue » décrit par Zola dans L’OEuvre au fastueux hôtel particulier du peintre Meissonier édifié dans la Plaine Monceau. Conformément à leur statut de notable, ou désireux de fuir la ville, certains artistes font également construire des ateliers de villégiature, irriguant des communautés artistiques hors de la capitale.
C’est après la Première Guerre mondiale que l’intérêt des pouvoirs publics pour la catégorie des « travailleurs intellectuels », éprouvés par la violence de la crise économique, va se structurer. D’abord à Paris, puis dans le cadre de l’action de l’office départemental des Habitations à bon marché de la Seine (ODHBMS), la réalisation de dizaines d’ateliers intégrés à des programmes d’habitations à loyer modéré parisiens ou dans les cités-jardins de la petite couronne va permettre l’accession à des ateliers-logements.
Parallèlement, l’atelier d’artiste, lorsqu’il n’est pas modeste réemploi de bâtiments artisanaux, devient un laboratoire pour les architectes modernes, parmi lesquels Robert Mallet-Stevens, Auguste Perret, Le Corbusier, ou encore André Lurçat. La simplicité de ses volumes permettant une grande variété d’agencement, la forme de l’atelier inspire la réalisation de logements privés, où les codes de la vie de bohème sont adaptés à des hôtels ou à des immeubles.
Après la Seconde Guerre mondiale, la désaffection progressive du modèle de l’atelier, lié à un type de représentation de l’artiste, est compensée par la création par l’État d’aides à destination des collectivités territoriales, complétées en 1982 par la volonté du conseil régional.
(...)
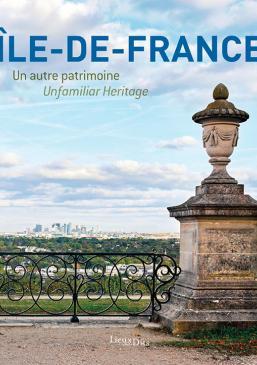
L'Ile-de-France, un autre patrimoine : Unfamiliar Heritage
Partager la page


