En Île-de-France, les universités et grandes écoles se sont multipliées dès le 13e siècle ; le premier lycée, Louis-le-Grand, date de 1802. Tour d'horizon par Brigitte Blanc et Emmanuelle Philippe, conservatrices du patrimoine, dans l'ouvrage "L'Île-de-France, un autre patrimoine". Découvrez-en un extrait.
L’ouvrage "L'Île-de-France, un autre patrimoine" s'appuie sur 40 années de recherche à l'inventaire général, et invite à découvrir ou redécouvrir les mille et une facettes du patrimoine francilien : ses églises gothiques et ses châteaux Grand Siècle, mais aussi ses aérogares, ses stades, ses cités-jardins et ses villes nouvelles, en passant par ses paysages de bord de Seine ou ses villages de caractère, qui ont inspiré les grands peintres du XIXe siècle. Découvrez tous les mois un extrait de chaque thématique abordée dans l’ouvrage.
L'Ile-de-France : lycées, universités et centres de recherche
Lieux de transmission des savoirs et d’apprentissage de la vie en société, les lycées ont plus de deux siècles d’existence. C’est par la loi du 1er mai 1802 que Napoléon Bonaparte crée cette institution pour la formation des élites, alors exclusivement masculines. Il impose la fondation de quarante-cinq établissements en France, dont quatre à Paris. Le premier est le lycée Impérial, rebaptisé Louis-le-Grand, installé dans les anciens murs du collège jésuite de Clermont. Jusqu’au milieu du XIXe siècle, rares sont les constructions neuves car la plupart des lycées sont aménagés dans des bâtiments congrégationnistes, dont la morphologie introvertie, proche de celle des cloîtres, s’adapte parfaitement à leur discipline militaire.
La démocratisation de l’éducation initiée par les lois de Jules Ferry (1881-1882) et l’ouverture aux filles de l’enseignement du second degré (1880) provoquent une nouvelle vague de constructions : édifiées sur les axes percés par le préfet Haussmann, elles se démarquent par la largeur de leur emprise, leurs façades imposantes et leur décor à la gloire des valeurs de la Troisième République. Dans le même temps, des architectes imprégnés de rationalité et d’hygiénisme travaillent à forger de nouveaux modèles comme celui du lycée Lakanal, le premier érigé « aux champs » hors de Paris, à Sceaux (1882-1885), par Anatole de Baudot. En 1934, Charles Le Coeur livre avec le lycée de jeunes filles Camille-Sée, en béton rose, le prototype de l’établissement moderne.
Alors qu’un million d’élèves intègrent l’enseignement secondaire en 1960, les lycées, comme les grands ensembles, adoptent dans toute l’Île-de-France une architecture sérielle, où la trame d’1,75 m, rendue obligatoire par le ministère de l’Éducation, favorise l’assemblage d’éléments préfabriqués. Les lois de décentralisation de 1983, qui confient aux Régions la gestion des lycées, inaugurent une page inédite de leur histoire : majoritairement implantés en banlieue, où ils équipent de nouveaux quartiers, le recours systématique aux concours d’architecture, mettant en concurrence des agences internationales, leur confère des silhouettes variées, privilégiant les matériaux bruts comme le verre, l’acier ou le bois. En 1997, Massimiliano Fuksas réalise à Alfortville le premier lycée Haute Qualité Environnementale de France, à l’empreinte écologique réduite, tandis que Paul Chemetov, Roger Taillibert ou Architecture Studio contribuent à renouveler par leurs propositions innovantes le dialogue entre architecture et pédagogie.
Dans le domaine de l’enseignement supérieur, Paris se caractérise par l’ancienneté et le poids de ses universités et plus encore de ses grandes écoles. À compter du XIIIe siècle, la multiplication des collèges, fondés par des ordres religieux ou des bienfaiteurs, façonne le paysage du Quartier latin qui s’affirme comme un des plus importants foyers universitaires d’Europe. Celui ouvert en 1257 par un chapelain du roi, Robert de Sorbon, est à l’origine de la Sorbonne, reconstruite au XVIIe siècle sur ordre de Richelieu, puis entre 1883 et 1901 sous l’aspect d’un « palais universitaire » par l’architecte Henri-Paul Nénot.
(…)
Construire pour apprendre : tout un programme décliné au fil du temps depuis les premiers lycées impériaux implantés à Paris. Amplement diversifiée au XXe siècle, exportée au-delà des limites de la capitale, en petite et grande couronne, l’architecture des lycées n’a cessé de se transformer pour s’adapter aux évolutions pédagogiques. Elle va progressivement s’affranchir des modèles anciens du cloître ou de la caserne pour puiser son inspiration toujours plus librement dans les registres de l’usine, de l’hôtel de ville, de l’immeuble de bureaux, du campus universitaire ou encore du paquebot et de l’aéroport… En tension entre les contraintes d’un équipement public et le bien-être des élèves et des enseignants, les architectes ont tenté de renouveler la forme et souvent fait preuve d’audace et d’imagination. C’est cette histoire, parfois méconnue ou oubliée, mais toujours présente dans le quotidien de la vie scolaire, que cet ouvrage se propose de redécouvrir en arpentant les cours et couloirs de près de quarante établissements d’Île-de-France, retenus pour recevoir le label Architecture contemporaine remarquable, attribué par le ministère de la Culture, afin de distinguer leur valeur historique, architecturale et artistique.
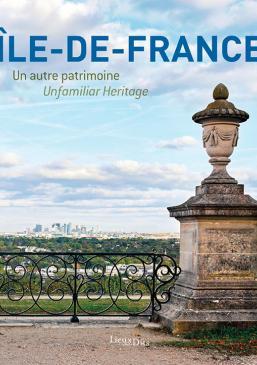
L'Ile-de-France, un autre patrimoine : Unfamiliar Heritage
Partager la page



